Galeriste et non marchand – il tient à cette subtile différence –, Fabio Sargentini a donné un souffle nouveau à la scène culturelle romaine en lançant Pino Pascali, Jannis Kounellis, Gino De Dominicis, Luigi Ontani, mais aussi les protagonistes de la Nuova scuola romana.
Comment vient l’intuition qu’un artiste a quelque chose en plus ?
J’ai commencé très jeune. Enfant, j’avais vu beau-coup de peintures chez mes parents, mon père était en effet collectionneur. Quand il a ouvert une galerie en 1957, il avait 47 ans – j’en avais 18 – et a fait preuve de beaucoup de courage en consacrant sa première exposition à l’art informel, qui incluait notamment le sculpteur Leoncillo. C’est l’intimité avec les œuvres d’art qui exerce l’œil, il est fondamental de voir dal vivo et de ne pas se contenter de feuilleter des livres. Je me suis rendu compte, au fur et à mesure des années, que mon regard était plus prompt et plus perspicace que celui de nombreux critiques célèbres qui écrivent de très beaux textes sur la théorie de l’art, mais peinent à déceler quelque chose en devenir, qui n’existe pas encore… Le secret de ma carrière réside dans cette aptitude à sentir avant les autres ce qui est caché chez les jeunes artistes.
Vous commencez votre carrière en 1966. Et dès juin 1967, vous réunissez dans l’exposition « Fuoco Immagine Acqua Terra » Pino Pascali, Jannis Kounellis, Umberto Bignardi, Mario Ceroli et Michelangelo Pistoletto. C’est trois mois avant l’exposition « Arte Povera » organisée à la galleria La Bertesca par Germano Celant, où figuraient notamment les mêmes artistes.
Lorsque je me suis lancé, j’ai adopté un parti pris précis avec un sculpteur, Pino Pascali, et un peintre, Jannis Kounellis. Tous deux me paraissaient en mesure d’ouvrir un champ nouveau par rapport au pop art qui avait commencé à dominer Rome et dont Mario Schifano était l’un des protagonistes. Pino et Jannis étaient alors représentés par La Tartaruga, mais Plinio De Martiis avait une préférence nette pour Schifano, ce qui a facilité les choses. Je dirais même qu’au fond, il a dû ressentir un certain soulagement. J’ai découvert les œuvres de Pino Pascali avant de connaître l’homme. En janvier 1966, j’avais vu ses Armi [Armes] chez Sperone, à Turin, et, de retour à Rome, j’ai cherché à le rencontrer. J’ai alors appris que Plinio avait refusé d’exposer ces œuvres, ce qui avait conduit Pascali, par l’entremise de Pistoletto, à les présenter à Turin. J’ai acheté tous les Armi, c’était comme une évidence. Un peu plus de six mois plus tard, fin octobre, j’ai inauguré ma galerie par une exposition en deux volets dédiée à Pascali, afin de montrer l’ensemble de ses nouvelles créations. Lors de la présentation du deuxième volet (fin novembre-début décembre), Il Mare m’a fait comprendre qu’aux yeux de Pascali, l’exposition formait un tout avec l’espace. Les visiteurs devaient raser les murs, puisque l’œuvre, constituée de vingt-quatre blocs, occupait toute la salle. La galerie était au début un espace contemplatif. Le public s’y déplaçait librement pour regarder les peintures encadrées et accrochées sur les cimaises. Pino Pascali a littéralement éventré, ou défloré, cet espace que je partageais avec mon père au dernier étage de la piazza di Spagna. Il a mis en crise le lieu même.
Quels sont alors les rapports entre Pino Pascali et Jannis Kounellis ?
J’avais d’abord choisi Pascali. Puis j’ai découvert une œuvre de Kounellis, une rose, via del Babuino. Un ami l’avait achetée et mise dans sa vitrine. J’ai aussitôt voulu ren-contrer l’artiste et ai demandé à Pino : « Que penses-tu de Jannis ? Son travail me plaît beaucoup. » Il m’a répondu : « Prends-le, il est très fort. » Madonna mia ! Il était si généreux envers les autres artistes, insistant toujours : « Propose une exposition à l’un, à l’autre… Fais une exposition à Renato ! » Mais je n’ai pas organisé d’exposition de Renato Mambor. La disparition de Pascali en septembre 1968 a empêché que la rivalité entre Kounellis et lui se concrétise. Pino avait pourtant compris Jannis mieux que personne. Il disait : « Gianni, je le connais bien. Il ne te permet pas d’être son ami. » Il avait perçu cette distance, impossible à surmonter : Kounellis est toujours resté le Grec du Pirée qu’il était.
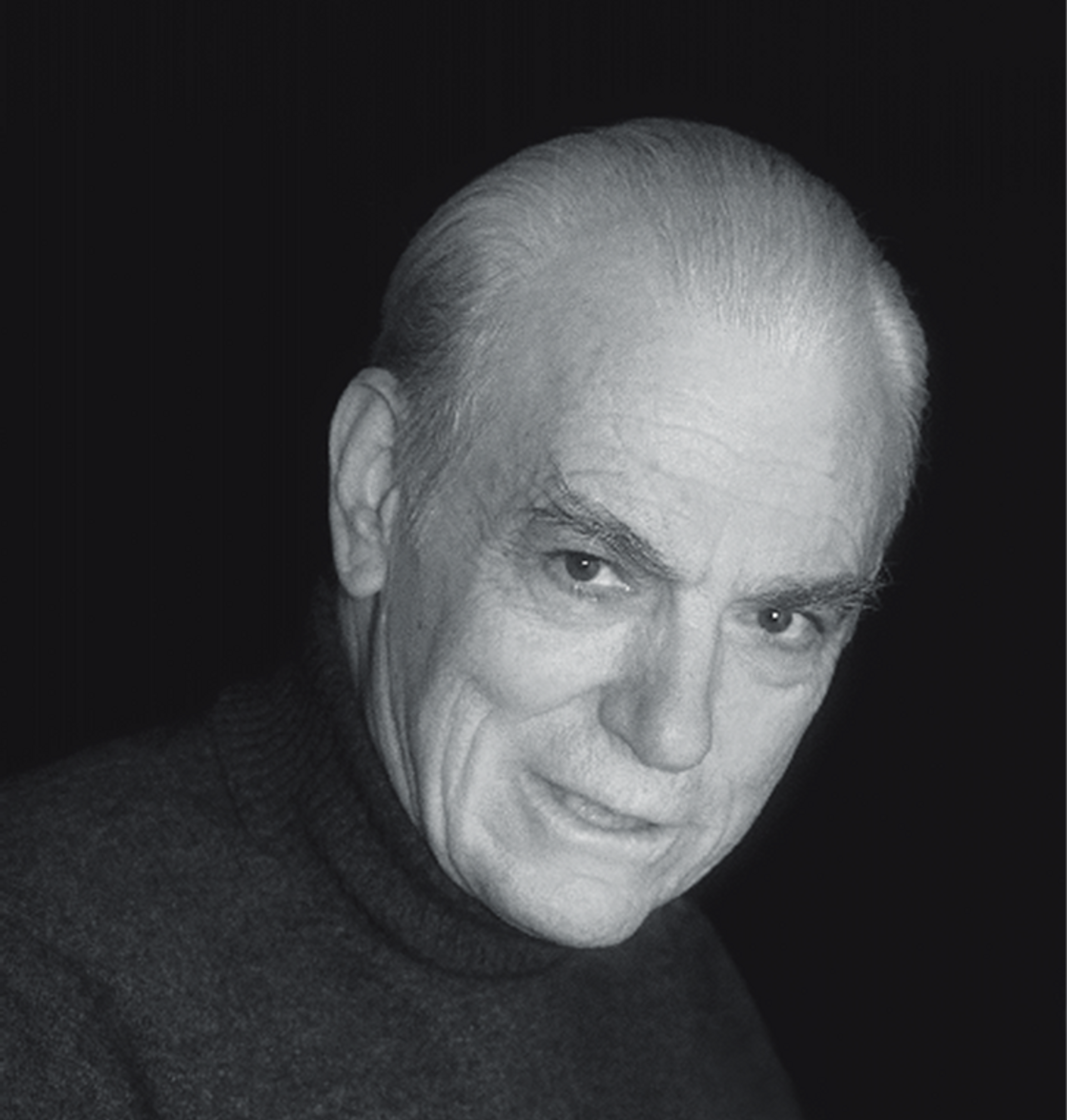
Fabio Sargentini Courtesy Fabio Sargentini / Archives L'Attico
Vos rapports avec Pascali dépassaient en revanche de loin le cadre de la relation entre un galeriste et un artiste… Quel est votre plus beau souvenir le concernant ?
Nous avions beaucoup en commun. En septembre dernier, à l’occasion des cinquante ans de la disparition de Pino Pascali, Valérie Da Costa, spécialiste de son travail, a organisé une soirée d’hommage au cours de laquelle j’ai lu un petit texte qui relate une course folle en voiture entre Paris et Rome. Nous avions quitté Paris à 10 h du matin et sommes arrivés à Rome à 4 h le lendemain matin. Pino conduisait une voiture de course. À la tombée de la nuit, alors qu’il venait d’allumer les phares, nous sommes restés ébahis devant un ciel extraordinaire, d’une incroyable puissance. Il a dit : « La nature, personne ne peut la tromper. » Il pensait à l’art, aux artistes de tous les temps, lui compris. Nous roulions vers Rome à grande vitesse, une trop grande vitesse…
C’était l’année de sa mort ?
Cinq mois avant sa mort, dont tout le monde connaît les circonstances tragiques [Pino Pascali est mort dans un accident de moto sur la via del Muro Torto, à Rome]. Autour de son cercueil, il y avait Cesare Tacchi, Jannis Kounellis, Maurizio Calvesi, Vittorio Rubiu, Gian Enzo Sperone et moi : deux artistes, deux critiques, deux galeristes.
Peu après, vous avez installé L’Attico dans un garage via Cesare Beccaria, à deux pas de la piazzale Flaminio.
Pascali avait éventré L’Attico nuovo avec Il Mare. Il m’avait fait comprendre le concept d’installation, même s’il n’employait pas ce terme – il l’appelait « ingombro totale ». Pendant les deux années qui ont suivi, il m’encourageait à changer d’espace, puisque celui-ci ne pouvait plus fonctionner. Mais il me manquait une composante. Il ne s’agissait pas seulement de trouver un lieu plus grand – j’aurais très bien pu choisir un dernier étage, plus vaste. Il fallait concevoir autrement l’espace d’exposition. Après la disparition de Pino qui me suggérait une vision d’installation, j’ai eu la chance de rencontrer Simone Forti, qui m’a insufflé une vision performative. Elle arrivait de New York, où peintres et sculpteurs étaient étroitement liés au monde du théâtre et à la danse. Or, là-bas, les galeries se trouvaient au sommet de gratte ciel, nécessitant pour y accéder de prendre un ascenseur. J’ai alors demandé à un agent immobilier de me trouver un lieu plus grand. J’ignorais que ce serait finalement un garage, qui plus est au-delà de la piazzale Flaminio, qui semblait loin du centre, mais n’était en réalité qu’à 200 mètres de la piazza del Popolo. C’était important d’être dans le centre sans trop y être. via Cesare Beccaria, il y avait un salon de coiffure, une officine d’avocat et L’Attico. Après l’ouverture, je me suis rendu pour la première fois à New York – j’avais 29 ans –, avec l’impression de devancer tout le monde, puisque j’étais le seul underground. Le garage était devenu un espace de projection où la liberté d’expression était totale.
C’est le début d’une formidable aventure, qui appartient désormais à l’histoire…
Pino Pascali est mort le 11 septembre 1968. En janvier 1969, pour la première exposition dans le nouveau lieu, Jannis Kounellis a présenté I dodici cavalli vivi [Douze chevaux vivants] : ce n’était pas une étable, c’était de l’art ! Sur les photographies de l’exposition réalisées par Claudio Abate apparaît un jeune homme qui se promène. Quelques mois plus tard, cet inconnu, Gino De Dominicis, m’a rendu visite et je l’ai reconnu. Je l’ai exposé une première fois en novembre, puis il a présenté en janvier 1970 Lo Zodiaco. Avec cette œuvre, il apportait une vision cérébrale de l’art, celle de Duchamp, même s’il n’aimait pas se l’entendre dire. Il a fait entrer l’art conceptuel au garage. L’installation se composait de douze objets inanimés ou êtres vivants, chacun correspondant à un signe du zodiaque. Entre les chevaux de Kounellis, qui montrait que l’art égalait la nature, et Le Zodiaque, une opération mentale, immatérielle, s’était produite. Gino avait pris quelque chose à Jannis. De cet épisode date notre rupture.
Serait-il possible de revenir un instant sur la présence de tous ces animaux?
Pour l’exposition de Kounellis, j’ai loué des chevaux à la Villa Borghèse, qui y étaient raccompagnés chaque soir, car ils ne passaient pas la nuit à la galerie. Je me souviens même que la location me coûtait 10 0000 lires par jour.
Pino Pascali a littéralement éventré cet espace que je partageais avec mon père piazza di Spagna. Il a mis en crise le lieu même.

Jannis Kounellis, Douze chevaux vivants, L’Attico, garage via Beccaria, Rome, 14 janvier 1969. © Claudio Abate, courtesy Fabio Sargentini/Archives L’Attico © Claudio Abate, courtesy Fabio Sargentini / Archives L’Attico
Pour Le Zodiaque, il me semble que c’était le zoo de Rome qui nous avait loué les animaux. Rien de tout cela ne serait plus possible aujourd’hui ! C’était fou. Tant et si bien qu’un jour, alors que je me trouvais à L’Attico de la piazza di Spagna, où exposait un artiste espagnol informel, Rafael Canogar, est apparu Salvador Dalí qui m’a lancé de but en blanc : « Pourrais-tu me trouver un éléphant pour parcourir Rome et me rendre au Panthéon? » Je lui ai répondu que j’étais désolé, mais que je n’en étais pas capable! [Rires]
En cette folle année 1969, c’est aussi à Rome le début du Land art.
En juin, j’ai organisé Danza Volo Musica Dinamite, le premier festival de danse et d’art. En septembre, est arrivé à Rome Robert Smithson, à qui j’ai consacré une exposition. À ce moment-là, nous avons senti qu’il existait une correspondance entre les premières briques ayant formé l’édifice de l’Arte Povera – l’eau et la terre de Pascali, le feu de Kounellis – et les prémices du land art. Malgré leurs différences, Italiens et Américains avaient adopté une même direction. En octobre, j’ai aidé Smithson à mettre en œuvre la réalisation d’Asphalt Rundown, une coulée de ciment bouillonnant sur Cava di Selce, près de l’aéroport de Ciampino. Le matin même, voulant que Claudio Abate immortalise l’instant, j’ai débarqué chez lui et l’ai réveillé après une soirée bien arrosée. Je suis allé lui chercher un cappuccino au bar d’à côté, il l’a avalé,s’est habillé. Au moment de partir, Claudio m’a dit : « L’appareil photo est au mont-de-piété. – Très bien, allons-y. » J’ai payé et nous voilà partis. L’image est certes célèbre aujourd’hui, mais tout cela tenait à peu de chose !
En quittant le garage, en 1976, vous l’avez littéralement noyé en le remplissant de 50 000 litres d’eau.
Pendant trois jours, je l’ai laissé comme un lac immobile : l’eau ne bougeait pas, elle épousait l’espace. C’était une action très forte. Il était impératif de formaliser cette inondation. L’art italien est fait de réminiscences : la mer de Giorgio de Chirico et Il Mare de Pino Pascali m’y avaient porté. Mon premier acte artistique avait été de m’installer dans ce garage; mon deuxième, de l’inonder.

