Pourquoi avoir attendu soixante ans de carrière pour exposer, enfin, en galerie ?
Disons que, pendant longtemps, exposer mes photos n’était pas ma préoccupation première. J’étais plutôt voyageur, reporter, journaliste, j’écrivais des textes, je faisais des films documentaires et même des fictions, je publiais des livres. Je pense aussi qu’il était nécessaire de laisser passer du temps, il fallait que mes photos « vieillissent ». Peut-être que les progrès arrivés entre-temps – l’évolution technique des tirages, des scans et même des encadrements – m’ont également ouvert de nouvelles perspectives.
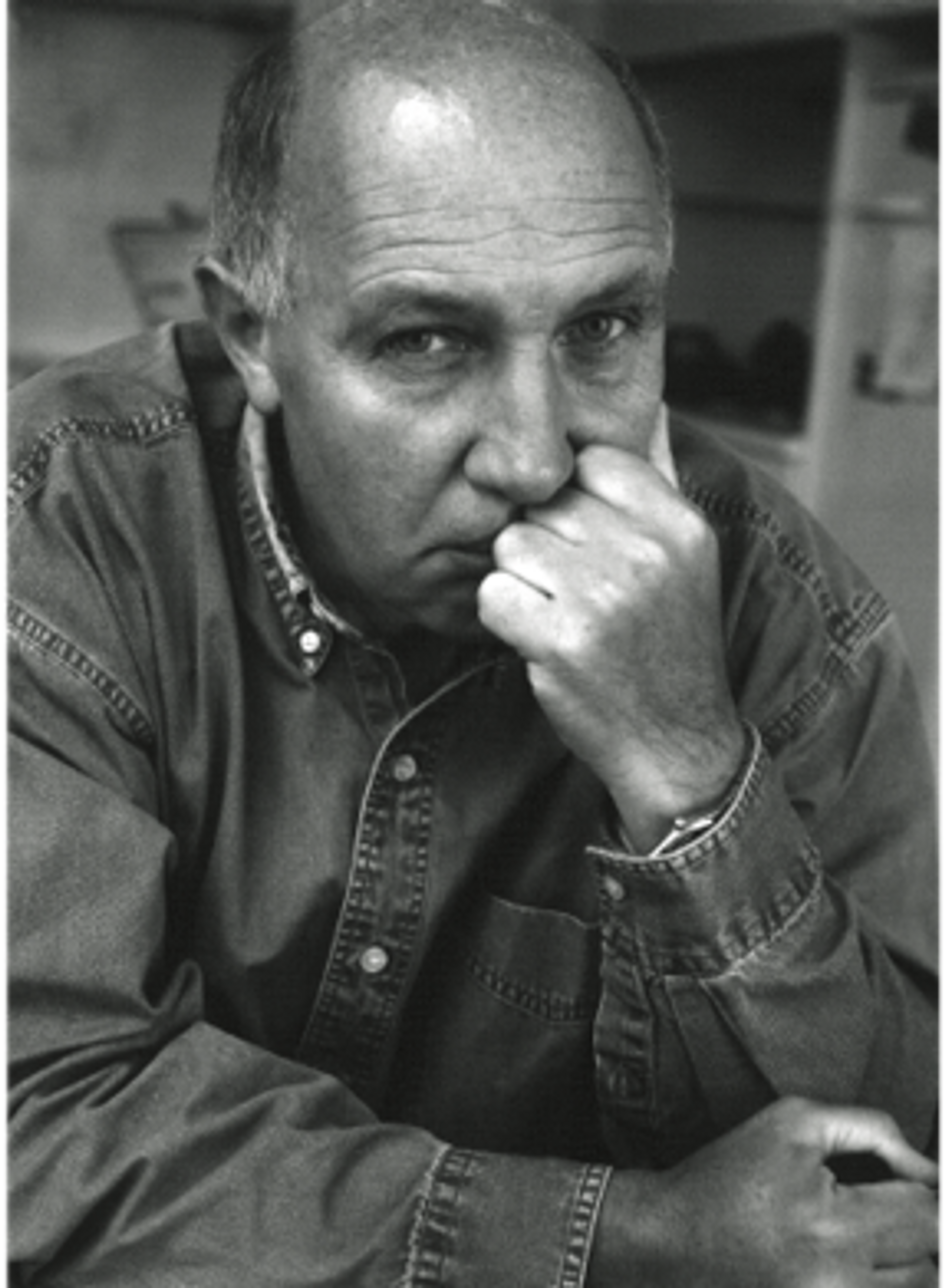
Raymond Depardon, Autoportrait 1992. Courtesy Raymond Depardon
Vous avez choisi de montrer des photographies d’une série ancienne (1984), liée à la ferme du Garet, dans le Lyonnais, qui appartenait à vos parents, et à ses alentours. En amenant dans une galerie d’art contemporain du foin, des vaches, la table de la cuisine familiale, n’avez-vous pas le sentiment de faire un pied de nez à ce que l’on peut attendre de la modernité ou de la contemporanéité ?
On m’avait demandé, en 2006, pour les Rencontres d’Arles, d’exposer ces photos de la ferme du Garet et, à l’époque, je m’y étais opposé. Peut-être que je n’étais pas prêt encore à montrer cette ruralité. Il a fallu que j’exorcise, d’une certaine façon, le complexe que j’avais d’être un fils d’agriculteur. Les trois films sur les paysans que j’ai réalisés avec Claudine Nougaret ont été une bonne thérapie. Les Américains m’ont aussi beaucoup aidé à me décomplexer, notamment les photographes qui ont travaillé pour la Farm Security Administration. Je me suis dit qu’il n’y avait pas de raison que je ne puisse pas, à mon tour, photographier la ferme de mes parents ou filmer les paysans dans les Cévennes. Là encore, je pense qu’il fallait donner du temps au temps.
La photographie américaine a donc eu une grande influence sur vous ?
Ah oui, oui ! Walker Evans et Paul Strand ont joué un rôle prépondérant dans ma vie. Robert Frank aussi, de même que des photographes moins connus, qui ont travaillé dans la rue, comme Charles Harbutt ou Burk Uzzle, et des cinéastes comme Richard Leacock ou [Donn Alan] Pennebaker, qui ont inventé le cinéma direct. Quand j’ai rejoint l’agence Magnum, en 1978, j’avais des discussions sans fin avec le photographe Gilles Peress, qui vivait à New York. Il nous traitait sans cesse, nous autres les photographes français, de « romantiques », nous reprochant, avec humour, d’aimer les ciels sombres. J’ai fini par comprendre que les Américains photographiaient la ruralité, ou la ville, de façon plus crue que nous. J’étais fasciné par leur façon très moderne de cadrer des sujets simples qui pouvaient passer pour des tartes à la crème.
Vous avez été marqué également par les écrits d’auteurs, comme James Agee ou Claude Lévi-Strauss…
Bien sûr. Les lectures de Tristes Tropiques, de Claude Lévi-Strauss, et de Louons maintenant les grands hommes, de James Agee, illustré de photographies de Walker Evans, ont été un double choc pour moi. Lévi-Strauss a été l’un des premiers à dénoncer l’ethnocentrisme du photographe occidental, qui part prendre des images en Afrique, en Amérique du Sud, dans le Proche-Orient, qui les ramène chez lui et les vend. Je suis pour ma part un pur photographe de la décolonisation. J’ai commencé la photographie en 1960, au moment des grands mouvements d’indépendance. On m’envoyait en Algérie, en Côte d’Ivoire. Dans les années 1970, Lévi-Strauss (et d’autres) a remis en question ce fameux statut de reporter photographe et même celui de voyageur, puisque, comme il l’a écrit, il haïssait les voyages et les explorateurs.
Est-ce ce qui vous a amené à adopter un statut d’auteur et à vous engager davantage dans vos photographies qu’auparavant ?
Oui, d’autant que j’ai été également influencé par Roland Barthes, qui faisait se rapprocher l’image de l’écrit. Barthes disait qu’un texte, une légende sont, par rapport à une image, soit « relais », soit « ancrage ». Je sortais alors de vingt-cinq ans de photos avec des légendes « ancrage », qui rapportent les faits, rien que les faits. Contrairement aux textes relais qui n’ont pas nécessairement un lien direct avec l’image. J’ai commencé à écrire pendant que j’étais à Beyrouth, à la fin des années 1970. J’étais souvent seul en reportage – cette fameuse solitude du reporter photographe –, et je me suis mis à écrire, en prenant des notes, un peu à la façon que l’on avait d’écrire au XIXe siècle.
« Pendant longtemps, exposer mes photos n’était pas ma préoccupation première. Je pense qu’il était nécessaire de laisser passer du temps. »

Raymond Depardon, Sans titre, 1984, tirage argentique réalisé à l’agrandisseur sur papier RC, 1997. Courtesy Raymond Depardon et galerie RX, Paris
Conservez-vous vos carnets de notes ?
Oui, j’en ai beaucoup. J’ai d’ailleurs commencé à les faire taper.
Au début des années 2000, pour votre projet sur la France, vous avez arpenté tout le territoire au volant d’un camping-car. Vous qui avez voyagé quatre ans durant à travers le pays, avez-vous vu venir le mouvement des gilets jaunes ?
Oui, parce que j’avais choisi – étant né à Villefranche-sur-Saône, c’est-à-dire une sous-préfecture – de photographier précisément ces villes de moyenne importance, un peu à la marge des grands axes, de montrer toutes ces zones périurbaines, ces ronds-points, dont on ne parlait alors quasiment pas. Je me suis arrêté, j’ai discuté avec ces habitants tout en me disant que si je n’étais pas devenu photographe, je serais sans doute parmi eux. C’est cette France-là qui m’intéressait, pas celle de l’hypercentre de Lyon ou de Marseille. Il s’agit de villes en perte de vitesse, en décrépitude pour certaines d’entre elles. On m’a reproché – notamment des élus – d’avoir montré des rues, des trottoirs en mauvais état. Mais j’ai appuyé justement là où ça faisait mal, il y a quinze ans déjà. Je voyais bien que ces gens-là, en particulier les femmes – très présentes parmi les gilets jaunes –, étaient à la fois confrontés à la modernité de ces zones périurbaines et à la désorganisation du territoire, due notamment à la désindustrialisation et à la dispersion des services publics.
Qu’est-ce qui vous a incité et vous incite encore à aller à la rencontre de vos compatriotes, à travers les films que vous avez tournés sur les paysans, la justice, la psychiatrie, la police ?
Je suis monté à Paris en 1958 pour apprendre la photographie, mais, très vite, je me suis retrouvé à photographier Brigitte Bardot ou le général de Gaulle. C’était un peu un non-sens pour moi. Au début des années 1980, alors que j’avais déjà pas mal bourlingué à l’étranger, j’ai senti le besoin de réparer cela. Lorsque je suis en « décalage » par rapport à mon pays, j’entends une voix qui me dit : « Raymond, tu dois revenir aux sources. » Dans le désert, en haut d’une dune, quand je m’ennuie un peu, il m’est arrivé de penser : « Il faut que je fasse un film sur un commissariat ou sur la vie dans un hôpital ! »
Quelques années après votre travail photographique sur la France, vous avez conçu, d’une certaine manière, son pendant au cinéma, Les Habitants (2016). Dans ce film, vous allez à la rencontre des Français en leur donnant la parole dans une caravane et en les filmant en plan fixe de profil. Avez-vous le sentiment que certains sujets ne se suffisent pas de la photographie, par définition muette…
C’est vrai qu’il n’y a que la parole pour délivrer le genre d’informations que nous avons entendues dans cette caravane, Claudine et moi. Tout d’un coup, ces femmes que nous rencontrions nous parlaient de leur pension, de l’éducation des enfants qu’elles assumaient seules, des boulots d’hommes qu’elles devaient parfois prendre pour s’en sortir. Et ça, c’est difficile, pour ne pas dire impossible, de le retranscrire en photographie. En revanche, la photographie me permettait de me faire plaisir visuellement, ou esthétiquement, car je ne suis pas en recherche systématique du « beau plan » de cinéma.
Le tandem que vous formez avec Claudine Nougaret, productrice et preneuse de son de vos films, vous a permis de créer autant des images que des espaces sonores. Pensez-vous que le son peut parfois faire image, avec plus de force que l’image elle-même ?
C’est évident, et je m’en suis aperçu dès le premier film que nous avons tourné ensemble, Urgences (1988). Ça a été un vrai miracle. Auparavant, je devais m’approcher, souvent trop près du sujet que je filmais, parce que je prenais le son aussi. Là, je n’avais plus qu’à choisir la position de ma caméra et m’y tenir. Je dis toujours que je suis comme un abat-jour ou un portemanteau, je ne bouge pas, je n’ai pas une présence ostentatoire. Cette osmose entre nous deux nous a permis de faire tous ces films où nous écoutons les gens, qui nous accordent en retour leur confiance.
En janvier prochain, Claudine Nougaret présentera son travail sur le son à la Bibliothèque nationale de France (BnF), à Paris, dans la galerie des Donateurs. Est-ce compliqué d’exposer du son ?
À l’origine, les chercheurs du laboratoire du CNRS d’Orléans nous ont demandé ce que nous comptions faire de tout ce matériel sonore que Claudine possédait depuis que nous travaillions ensemble. L’idée d’en faire don à la BnF est venue dans la foulée, assez naturellement. Pour l’exposition, c’est un challenge effectivement de mettre en écho des archives sonores et des photos ou des images tirées de mes films, de montrer le matériel technique dans des vitrines, d’exposer aussi des courbes de son analysées par ces chercheurs d’Orléans.

Raymond Depardon, Sans titre, 1984, tirage argentique par contact réalisé d’après négatif sur papier RC. Courtesy Raymond Depardon et galerie RX, Paris
La technique compte dans votre pratique photographique. Contrairement à Bernard Plossu qui utilise un Nikkormat depuis toujours ou Marc Riboud qui est resté fidèle au Leica, vous changez d’appareil photo selon les projets. Comment procédez-vous pour choisir tel ou tel format ?
C’est quelque chose qui me vient du cinéma. J’avais été surpris, un jour, par cette question de Pascale Dauman [la productrice de ses premiers films] : « Quel cadre veux-tu pour faire ce film-là ? » Je n’avais pas su quoi répondre parce qu’en cinéma analogique, il y avait à l’époque différents formats avec différents caches entre l’objectif et le film. Je me suis nourri de cette expérience. Et ça s’est accéléré quand j’ai découvert, dans les années 1990, le livre From the Missouri West de Robert Adams, dans lequel sont reproduits des paysages en hauteur. Je trouvais ça gonflé. Je me suis alors décidé à prendre un format en hauteur pour Errance [2000].
Était-ce en réaction à la tradition des grands photographes de l’Ouest américain, emmenée par Ansel Adams ?
Oui, sans doute. C’était une façon pour moi de « casser » la photogénie de ces lieux grandioses, de réfuter le rapport à la peinture aussi et aux peintres paysagistes du XIXe siècle. Le choix de la hauteur me permettait également de trouver une échappée par rapport au cadre horizontal et au format scope du cinéma.
« Si je devais faire un vœu, ce serait que mes archives intègrent une structure réunissant des photographes qui partagent une même forme de curiosité. »
Vous êtes retourné encore récemment aux États-Unis. Qu’est-ce qui vous incite à y revenir sans cesse ?
Je me suis rendu l’hiver dernier au Texas, et l’été dernier dans le Dakota. Mon but est d’arpenter les déserts américains – j’ai noté qu’il n’y en avait pas moins de sept –, mais j’ai voulu commencer par les prairies et les grandes étendues. Je suis tombé récemment sur un livre formidable sur le désert Mojave de Henry Van Dyke, un écrivain américain, contemporain de Henry David Thoreau. J’ai eu grand plaisir à lire ses écrits, qui n’ont rien à voir avec ceux des auteurs européens qui se sont emparés du désert africain et du monde arabe, au moment de la colonisation. Ça m’a vraiment plu, et j’ai envie de faire un livre sur le désert américain, avec des photos à la chambre 20×25. J’aime beaucoup ce format, dont le ratio 1/25 se rapproche des films muets que l’on voyait à la Cinémathèque. C’est un format presque carré, mais avec encore un haut et un bas, qui me permettent de jouer sur le ciel ou sur le sol. Il y a en même temps cette netteté incroyable, cet aspect rapport de gendarme…
D’ailleurs, votre travail comporte très peu de photographies floues. Diriez-vous que vous êtes un photographe de la netteté ?
[rires] Oui, je suis un peu primaire. Je porte des lunettes loupes et j’aime bien voir tout net. Je suis de la vieille école, même si j’ai un grand respect pour le photographe chilien Sergio Larrain, qui était beaucoup dans l’abstraction.
Ce fait de changer d’appareil photo presque à chaque projet ne vous a-t-il pas empêché d’avoir un style photographique reconnaissable ?
J’en ai souffert, c’est vrai, à un moment, d’autant que je passais rapidement du cinéma à la photo-graphie. Aujourd’hui, je le revendique comme un avantage. Je suis pluridisciplinaire, c’est tout.
Vous êtes un photographe très prolifique : vous avez édité plus de soixante livres. Êtes-vous préoccupé par la pérennité de votre fonds photographique ?
Oui, c’est une vraie question : comment faire pour transmettre, pour que tout cela soit accessible, ne reste pas dans des caisses ?
L’Institut pour la photographie, récemment créé à Lille, se prépare à accueillir des fonds de photographes. Avez-vous été approché par cette structure ?
Non, pas encore, mais j’en ai entendu parler. Il existe d’autres lieux aussi. Il y aurait également l’éventualité d’une fondation, mais je ne pense pas que ce soit la bonne solution pour moi, qui ai toujours joué collectif si l’on songe aux différentes agences auxquelles j’ai appartenu. Si je devais faire un vœu, ce serait que mes archives intègrent une structure réunissant des photographes qui partagent une même forme de curiosité. J’aimerais faire partie d’une unité qui soit en rapport avec son temps, avec les préoccupations de son temps, que cela ne soit pas centré sur mon seul travail, mais renvoie à la fois à ce qui est local et à ce qui est tourné vers l’autre, vers le monde.
Outre le travail que vous menez en ce moment sur les États-Unis, avez-vous d’autres projets ?
Oui, je suis en train de rassembler deux mots qui peuvent paraître antinomiques : les nomades et les villes. Je sais que ces deux mondes sont aux antipodes : les Bororos et les Peuls d’un côté, New York ou Minneapolis de l’autre. Mais il me semble que les nomades sont d’une modernité incroyable et qu’il existe aussi, dans les grandes mégalopoles, une forme de nomadisme incarné par tous ces gens qui se déplacent chaque jour pour aller travailler.
Vous êtes l’un des photographes et cinéastes les plus reconnus en France. Comment expliquez-vous qu’à l’exception d’une exposition au Grand Palais en 2013, aucune grande institution, comme le Centre Pompidou ou le musée d’Art moderne de Paris, ne vous a proposé une rétrospective ?
Je ne sais pas… Peut-être que les gens attendent que j’ai fini mon travail ou que je ne sois plus là.
Pensez-vous que les photographes français sont plutôt « maltraités » par les institutions hexagonales ?
Nous vivons dans le pays qui a inventé la photographie, dans une ville, Paris, où la photographie tient une place de plus en plus importante, où elle est devenue très populaire, mais c’est vrai que les photographes français ont du mal à être exposés ou, du moins, à avoir suffisamment de visibilité. Henri Cartier-Bresson a dû attendre d’être mort pour bénéficier d’une exposition à Beaubourg, il y a quelques années. Mais moi, j’aimerais bien être là quand même, pour apporter ma touche personnelle !
« Raymond Depardon. Intérieur-Extérieur », 6 novembre 2019 - 9 janvier 2020, galerie RX, 16, rue des Quatre-Fils, 75003 Paris.
« Claudine Nougaret: “Dégager l’écoute”. Le son dans le cinéma de Raymond Depardon », 14 janvier - 15 mars 2020, Bibliothèque nationale de France, galerie des Donateurs, quai François-Mauriac, 75013 Paris.

