Style rigoureux et accessible, sens achevé du récit, humour… Outre-Atlantique, cette légende vivante, née en 1925, suscite de longue date l’admiration de ses pairs et des lecteurs.
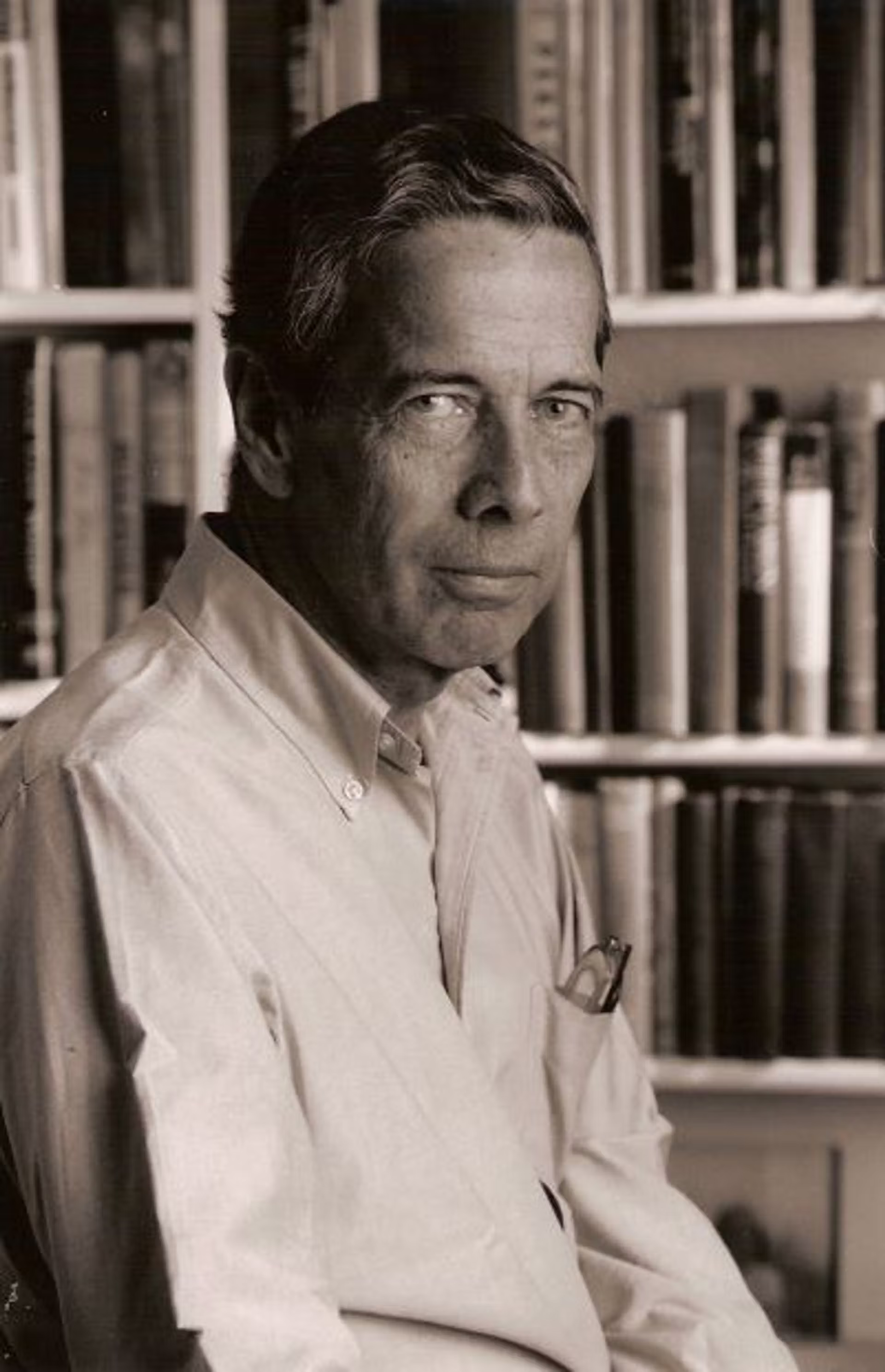
Calvin Tomkins. © Sara Barrett
Quel a été votre premier contact avec l’art ?
Mon père, qui était homme d’affaires, a commencé à collectionner des peintures au début des années 1930, pendant la Dépression. Il a acheté de petites œuvres de Raoul Dufy, Maurice Utrillo et d’autres modernistes français. Un jour, il est rentré à la maison avec un très grand tableau représentant un loup et trois petits dans une forêt sombre. Le vendeur lui avait affirmé qu’il était de Gustave Courbet. Mon père avait des doutes à ce sujet. Ma mère a plaisanté en disant que le « loup à la porte » était maintenant dans la maison. Il a appris plus tard que, comme il le soupçonnait, l’œuvre n’était pas de Courbet.
Quand avez-vous commencé à écrire sur l’art ?
En 1959, j’écrivais pour Newsweek. Le magazine ne couvrait pas l’art à l’époque, mais, par hasard, j’ai été chargé d’interviewer Marcel Duchamp, à l’occasion de la parution aux États-Unis de la monographie que lui avait consacrée Robert Lebel. J’ai décidé qu’il était l’être humain le plus insolite que j’aie jamais rencontré, et c’est vraiment à ce moment-là que j’ai commencé à écrire sur l’art et les artistes.
Comment avez-vous fait vos débuts au « New Yorker » ?
J’ai quitté Newsweek peu de temps après ma rencontre avec Duchamp, puis j’ai rejoint l’équipe du New Yorker en 1960.
En 1964, vous avez passé des après-midi avec Marcel Duchamp dans son appartement new-yorkais. Vous en avez tiré un livre : « Marcel Duchamp: The Afternoon Interviews » [Badlands Unlimited, 2013]. D’où est venu ce projet ? Quels souvenirs conservez-vous de ces conversations ?
Après avoir rencontré Duchamp en 1959, je suis resté en contact avec lui – il vivait à New York et était devenu citoyen américain. Au New Yorker, j’ai écrit de longs portraits à propos de toutes sortes de personnes, mais ceux que j’ai le plus appréciés résultaient d’entretiens avec des artistes. Mon premier portrait dans le New Yorker était consacré à Jean Tinguely. Je n’ai pas pu m’empêcher de remarquer que la plupart de ces artistes avaient été profondément influencés par Duchamp, et il était inévitable que j’écrive sur lui. Si je me souviens bien, nous nous retrouvions généralement pour déjeuner dans un restaurant français de la Sixième Avenue, près de l’appartement de la West 10th Street où il vivait avec sa femme, Teeny. J’ai posé beaucoup de questions, dont certaines sans doute moins pertinentes, mais il a su faire de chacune d’elles un jeu d’esprit surprenant et souvent brillant.
Au point que vous lui avez dédié une biographie [« Duchamp: A Biography », Henry Holt and Co., 1996]. André Breton le qualifiait d’« homme le plus intelligent du siècle ». Partagez-vous cet avis ? En quoi était-il si singulier ?
Je suis d’accord avec Breton. La plupart des gens qui connaissaient Duchamp ressentaient la même chose. Et pourtant, il n’a jamais fait le moindre effort pour impressionner les gens par son intelligence. Il a traversé le monde avec légèreté et a refusé de se prendre au sérieux. Tard dans la vie de Duchamp, l’historien d’art américain Alfred Barr, se référant aux ready-made, dont Duchamp avait toujours soutenu qu’ils étaient sans aucune qualité esthétique, a déclaré : « Ah, mais Marcel, aujourd’hui, certains sont si beaux ! » Duchamp a souri et a répondu : « Personne n’est parfait. »
« Les artistes sont des êtres humains, et tous les aspects désordonnés de la vie entrent dans leur travail. »
Avez-vous joué aux échecs avec lui ?
Non.
Vous avez aussi publié « Living Well is the Best Revenge » [Viking Press, 1971, réédition Museum of Modern Art, 2013], l’histoire de Gerald et Sara Murphy. Dans les années 1920, ce couple d’Américains a côtoyé à Paris, puis à Antibes, Pablo Picasso, Fernand Léger et d’autres artistes passés à la postérité. Comment est née cette idée ?
Les Murphy étaient mes voisins à Snedens Landing, une petite ville située au bord de l’Hudson. Nous sommes devenus amis. Fasciné par ce qu’il m’a raconté sur leur vie à Paris, j’ai exhorté Gerald à écrire sur cette expérience, mais il m’a répondu qu’il ne le ferait jamais – il avait trop de respect pour le métier d’écrivain. Finalement, un jour, je lui ai demandé ce qu’il penserait si j’essayais d’écrire à ce sujet. Lui et Sara y ont réfléchi et ont généreusement accepté. Ils ne possédaient pas de collection, mais l’une des propres peintures de Gerald (Guêpe et poire) est entrée au MoMA.

Coffret de The Lives of Artists. D.R.
La maison d’édition Phaidon a publié [en octobre 2019, uniquement en anglais à ce jour] un coffret de six volumes réunissant, sous le titre « The Lives of Artists: Collected Profiles », vos articles parus dans le « New Yorker ». On y croise, entre autres, Jasper Johns, John Cage, Yves Klein, Bruce Nauman, Cindy Sherman, Matthew Barney, James Turrell, Jeff Koons, Maurizio Cattelan, Damien Hirst… De tous les artistes que vous avez rencontrés et sur lesquels vous avez écrit, lequel vous a le plus marqué ?
Duchamp, bien sûr. Pour les raisons que j’ai citées.
Vous avez aussi consacré un autre livre à Rauschenberg [« Off the Wall: A Portrait of Robert Rauschenberg », Picador, 2005]. En quoi ce peintre vous a-t-il particulièrement intéressé ?
Pour moi, Rauschenberg est l’artiste qui a le mieux exprimé la vie et la pensée américaines dans les années 1960 et 1970. Le regarder travailler sur ses peintures selon le procédé de la sérigraphie m’a plus appris sur le processus artistique qu’autre chose. Il le voyait comme une collaboration avec les matériaux, et non comme une sorte d’ordre qu’il leur imposait. Ce n’était pas figé, mais ouvert au hasard et à toutes sortes d’autres influences ; et quand quelque chose qu’il avait fait le surprenait, il savait qu’il était sur la bonne voie.
L’une des spécificités de votre approche est votre intérêt pour la vie de l’artiste, les conditions entourant la création. « The Lives of Artists », titre du recueil de vos articles, est ainsi une référence à Giorgio Vasari. En quoi le style de vie d’un artiste ne peut-il, selon vous, être isolé de son œuvre pour pouvoir la comprendre ?
L’approche formaliste de l’art, telle que codifiée par le critique Clement Greenberg, a statué que chaque œuvre doit être abordée de manière isolée et selon ses propres termes, sans référence à la biographie ou à la pensée de l’artiste. Cette stratégie m’apparaissait inutile. Les artistes sont des êtres humains, et tous les aspects désordonnés de la vie entrent dans leur travail.
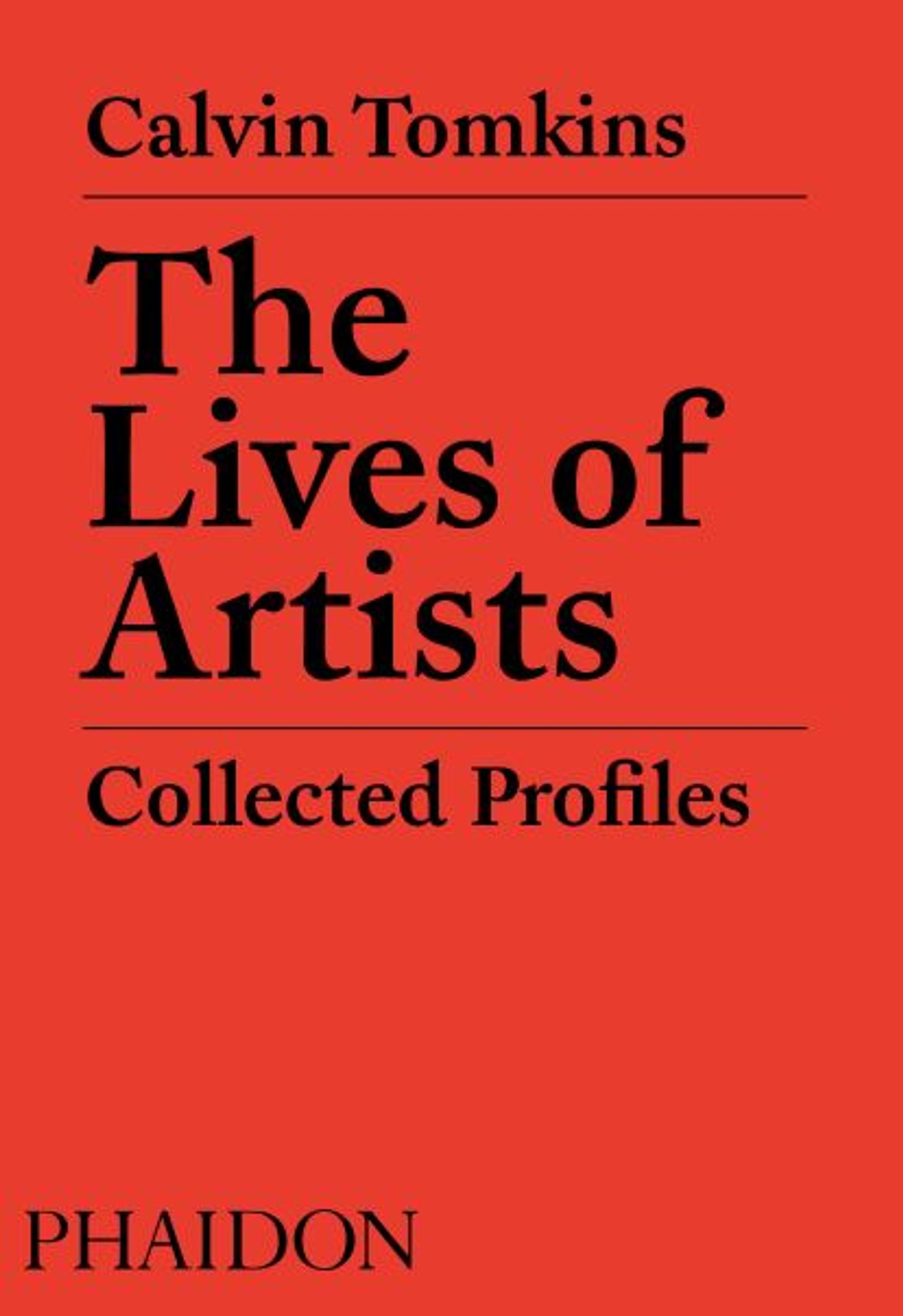
Calvin Tomkins, The Lives of Artists. D.R.
Regrettez-vous de ne pas avoir rencontré certains d’entre eux ?
Je regrette de ne pas avoir écrit sur Eva Hesse, Cy Twombly, Jean-Michel Basquiat, et bien d’autres.
Quel regard portez-vous sur le monde de l’art contemporain ?
La façon de faire de l’art a changé à cause de Duchamp. Avant, la plupart des gens pensaient savoir ce qu’était l’art, plus ou moins. Maintenant, ils ne sont plus si sûrs. Duchamp a redéfini ce que pouvait être l’art et, depuis, les artistes explorent les nouveaux territoires que son travail et sa pensée leur ont ouverts.
Après guerre, New York a détrôné Paris de la place enviée de capitale des arts, puis l’intérêt s’est porté vers d’autres cultures. Moins occidentalocentrée, cette histoire prend davantage en compte la diversité de la création. « Magiciens de la terre », exposition à l’initiative de Jean-Hubert Martin, en a été, dès 1989 (au Centre Pompidou, Paris), la manifestation… Que vous inspire cette évolution du regard ?
« Magiciens de la terre » a sans doute été l’exposition la plus importante du siècle. Il est triste de penser que ses implications mondiales ont coïncidé avec la destruction de la planète.
En fin observateur de la création depuis les années 1960, quels mouvements artistiques vous ont le plus marqué ?
L’expressionnisme abstrait, le pop art, le minimalisme, l’Arte povera, le conceptualisme. Après cela, nous avons cessé d’avoir des mouvements.
« J’ai décidé que Marcel Duchamp était l’être humain le plus insolite que j’aie jamais rencontré, et c’est vraiment à ce moment-là que j’ai commencé à écrire sur l’art et les artistes... »
Certains artistes vous semblent-ils surévalués ?
Bien sûr.
Êtes-vous collectionneur ?
Non.
Que vous inspirent la place qu’occupe aujourd’hui le marché de l’art, son évolution globalisée, les records de ventes aux enchères, les mégafoires ?
Une partie de cela a été destructrice pour la création artistique, mais ce n’est pas nouveau. Dans une certaine mesure, l’art a toujours été une marchandise.
Selon vous, comment se profile le « monde d’après », alors que l’économie de l’art, les musées, les artistes sont durement frappés par la pandémie de coronavirus, aux États-Unis comme partout sur la planète ?
De plus en plus de gens semblent penser que l’art est un investissement plus sûr que le marché boursier. Qui sait, c’est peut-être une industrie en croissance…
Comment définiriez-vous votre approche de l’écriture ?
Je ne suis pas critique. J’écris sur l’art parce que je pense que c’est l’une des activités les plus importantes et parce que les artistes me semblent plus vivants que le reste d’entre nous.
Quels sont vos livres de chevet ?
À mon âge, je ne suis plus capable de rester éveillé assez longtemps pour lire au lit !
Selon vous, qu’est-ce qu’un bon « arts writer » ? Quelles sont les qualités requises pour ce métier ?
Je n’en ai aucune idée.
Quel conseil donneriez-vous à un jeune critique ou journaliste qui voudrait suivre vos pas ?
Réfléchissez-y à deux fois.
--
Calvin Tomkins, « The Lives of Artists: Collected Profiles », New York, Phaidon, 2019, coffret de 6 volumes, 1640 pages, 125 euros.

