Avec désormais plus de 200 millions d’abonnés à travers le monde, Netflix compte parmi les grands gagnants des confinements successifs liés à la pandémie. À ses débuts cantonnée aux séries de fiction, la plateforme a su diversifier une offre mondialisée désormais pléthorique, au point de devenir incontournable. Il n’y a pas si longtemps encore, le documentaire y faisait figure de parent pauvre aux côtés de séries au succès planétaire, d’un catalogue de films « grand public » comme de classiques du cinéma et, plus récemment, de productions maison aux budgets hollywoodiens.
À de rares exceptions près – la série Abstract : l’art du design où apparaît Olafur Eliasson, le documentaire hagiographique Julian Schnabel : A Private Portrait ou quelques biopics consacrés à des artistes, plus ou moins convaincants (At Eternity’s Gate, sur Van Gogh, par le même Schnabel, cette fois réalisateur), pour ne citer qu’eux – l’amateur d’art restait sur sa faim.
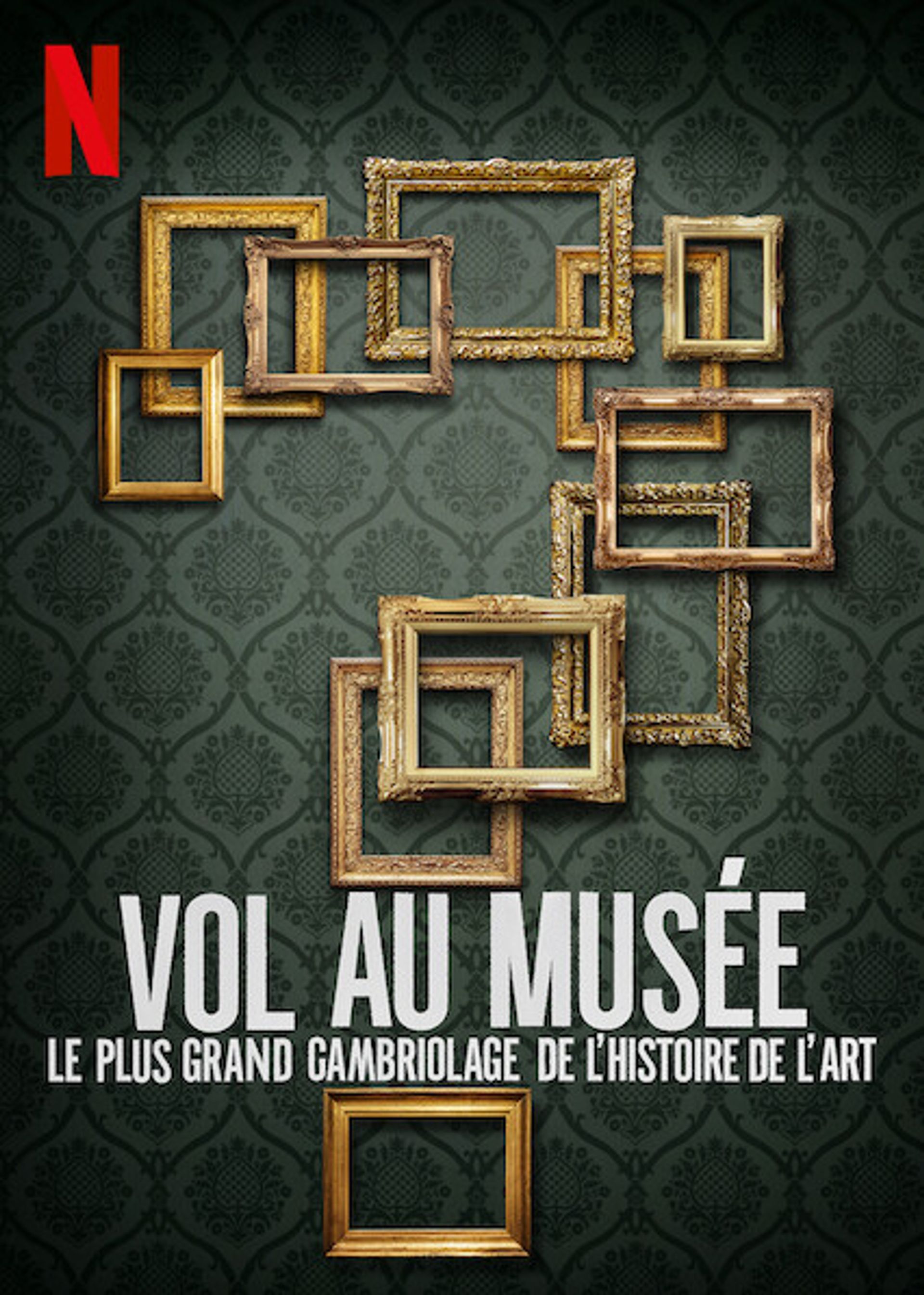
Le documentaire est diffusé, sur abonnement, sur la plateforme Netflix. D.R.
Depuis début avril, Netflix propose une minisérie originale en quatre épisodes sous la forme d’une enquête fouillée, intitulée Vol au musée. Le plus grand cambriolage de l’histoire de l’art. À grand renfort de témoignages, de formules parfois grandiloquentes (comme le laisse entendre d’emblée le titre) mais sur un ton accrocheur, le documentaire revient sur le vol, qui défraya la chronique en 1990, de treize tableaux de grands maîtres au musée Isabella Stewart Gardner de Boston.
Comme souvent dans les productions anglo-saxonnes, le montage efficace le dispute à un suspense haletant. Les producteurs sont ceux de The Irishman de Martin Scorcese, monstre sacré du septième art qui fit couler beaucoup d’encre en 2019 pour avoir vendu son âme au diable, aux yeux de certains, en choisissant de faire produire et diffuser par la plateforme son dernier long métrage, énième mais réussie saga sur le crime organisé dans l’Amérique de l’après-guerre à travers l’histoire de mafieux sur le retour.
De mafia, il en est aussi beaucoup question dans Vol au musée. Italienne ou irlandaise, elle est soupçonnée d’avoir fomenté ce braquage aussi spectaculaire qu’il a pu sembler être un jeu d’enfant pour les observateurs. « C’était un coup facile, comme on dit dans la rue », ironise l’un des intervenants. L’une des hypothèses d’abord avancées laisse à penser que les chefs-d’œuvre dérobés ont pu servir de monnaie d’échange pour négocier des peines de prison, voire acheter des armes pour l’IRA via des gangsters d’origine irlandaise, très actifs à Boston.

Depuis le vol, les cadres dans lesquels ont été découpées les toiles n’ont pas bougé. Isabella Stewart Gardner avait expressément stipulé que tout soit maintenu en l’état après sa mort. D.R.
Les regards se portent ensuite vers la Cosa Nostra, dont certains chefs (Ferrara, Donati) sont alors mis sous les verrous en Nouvelle Angleterre. Là encore, le vol d’art pour sortir de prison, voire à titre de garantie dans le trafic de cocaïne, serait une théorie probable. Le modus operandi pointe dans tous les cas dans la direction du crime organisé. Tous les participants au braquage ont été « éliminés » par la suite.
« C’ÉTAIT UN COUP FACILE, COMME ON DIT DANS LA RUE »
Retour sur la scène du crime. Dimanche 18 mars 1990, à Boston, dans le Massachusetts, le jour de la Saint Patrick (la parade bat son plein, la bière coule à flots : un jour parfait pour commettre un casse de nuit dans une partie désertée de la ville), deux hommes en uniformes de policiers sonnent à la porte du musée Isabella Stewart Gardner et y pénètrent sans encombres après que l’agent de sécurité leur a ouvert. Ils y restent plus de 80 minutes. Les impétrants n’ont pas choisi leur cible au hasard. Sous ses apparences de paisible musée de province, bâti autour d’un jardin intérieur sous une verrière, dans le style Renaissance d’un palais vénitien dissimulé derrière une austère façade, le musée recèle les trésors accumulés par sa créatrice, Isabella Stewart Gardner (1840 - 1924), collectionneuse d’art, philanthrope et mécène qui vivra jusqu’à sa mort dans les appartements privés du quatrième étage.
Les images d’archives parlent d’elles mêmes, complétées par les témoignages d’Anne Hawley, la directrice du musée à l’époque des faits, d’agents de sécurité, les analyses d’enquêteurs du FBI. Caméras détournées, pied de biche, gardiens ligotés au sous sol. Les cadres dorés ont été jetés au sol, pour certains toujours accrochés à leur emplacement d’origine. Les toiles, quant à elles, ont été sauvagement découpées au couteau, à même les cadres. Les voleurs semblent avoir pris la fuite de manière précipitée, laissant derrière eux des œuvres décrochées du mur – notamment l’inestimable autoportrait de Rembrandt, délaissé au même titre qu’un fleuron en bronze de drapeau napoléonien, sans valeur, à moitié dévissé. Acte prémédité, coup monté, le cambriolage étonne par le choix des pièces visées. Tout porte à croire que les lieux et les œuvres avaient été repérés.

Chez Tortoni, d’Edouard Manet, l’un des treize tableaux volés. En 2017, le musée a proposé dix millions de dollars de récompense à qui pourrait aider à retrouver les tableaux. © Isabella Stuart Gardner Museum
« À MOINS D’AVOIR DÉJÀ TROUVÉ UN ACHETEUR, C’EST PEUT-ÊTRE LE BRAQUAGE LE PLUS IDIOT DE L’HISTOIRE MODERNE »
Très célèbres, elles sont difficiles à revendre sur le marché légal de l’art. « À moins d’avoir déjà trouvé un acheteur, c’est peut-être le braquage le plus idiot de l’histoire moderne », commente un journaliste. Les cambrioleurs auraient agi sur commande, sachant ce qu’ils cherchaient, et pour qui.
Treize tableaux manquent à l’appel. Parmi les œuvres historiques dérobées dans la salle flamande par les malfaiteurs, Le Christ dans la tempête sur la mer de Galilée (1633), seul paysage maritime de Rembrandt, son Portrait d’une dame et d’un gentilhomme en noir (1633) et un petit autoportrait à l’eau forte du peintre; Le Concert de Vermeer; Paysage avec un obélisque (1638) de Govert Flinck; cinq œuvres sur papier d’Edgar Degas; Chez Tortoni (1878-1880), une huile sur toile d’Édouard Manet; un gobelet chinois ancien.
La valeur totale est alors estimée à 200 millions de dollars – un demi milliard aujourd’hui. Sollicités par le musée, Sotheby’s et Christie’s offrent 1 million de dollars de récompense pour qui aiderait à récupérer les tableaux. Plusieurs suspects sont passés en revue, dont un certain Myles Connor Jr, personnage haut en couleur, rockeur et plus grand voleur d’art revendiqué des États-Unis. Las, le suspect numéro un était derrière les barreaux au moment du forfait. Rick, le gardien qui a ouvert la porte aux faux policiers la nuit du vol, est soupçonné. Le relevé du fonctionnement des alarmes de sécurité est décrit à la minute près, salle par salle, par un spécialiste. Personne n’a jamais été inculpé.
Au fil du documentaire, le lien de complices possibles avec la mafia devient plus évident. Certains auraient pu informer des failles de sécurité du musée. « Les vipères allaient passer à l’attaque », commente un journaliste du Boston Globe. En 1997, un autre journaliste du Boston Herald affirme avoir vu Le Christ dans la tempête sur la mer de Galilée, conservé dans un rouleau, dans un entrepôt de Red Hook, à New York. Une femme raconte avoir accroché au mur pour son beau frère le Manet, qu’elle appelait « Tortellini » (et jugeait très mauvais!). Elle ne l’a plus jamais revu ensuite. De rebondissements en rebondissements, l’enquête avance, remontant l’historique du casse, tissant la toile des complicités, dans l’attente du moment de vérité. Le scénario se dessine, dans ses multiples et complexes détails : qui a participé, à qui a profité le crime… Des pistes, mais qui n’aboutissent à rien.
DE REBONDISSEMENTS EN REBONDISSEMENTS, L’ENQUÊTE AVANCE, REMONTANT L’HISTORIQUE DU CASSE, TISSANT LA TOILE DES COMPLICITÉS
Une enquête captivante, ficelée comme un bon polar, dont le dénouement laisse malgré tout, disons le, le spectateur un brin sur sa faim. À défaut de lever totalement le voile, en guise d’épilogue, la question reste entière : que sont devenus les tableaux ?
--
Vol au musée. Le plus grand cambriolage de l’histoire de l’art, mini-série originale, Netflix, sur abonnement.

