En 1995, Bruno Foucart frappe fort en créant à l’université Paris 4 une « unité de valeur » consacrée aux arts décoratifs, alors considérés comme des « arts mineurs ». Les enseignants en ce domaine étant rares, il fait appel à des enseignants-chercheurs associés et invités, des conservateurs de musée, des antiquaires… et un journaliste spécialisé, auquel on doit la redécouverte des décorateurs des années 1940. Jean-Louis Gaillemin fait ainsi école en invitant de jeunes chercheurs à poursuivre et affiner la réflexion critique sur les arts décora-tifs de l’entre-deux-guerres.

Fumoir de l’appartement de Jean- Michel Frank, rue de Verneuil, Paris, vers 1925 (lampe d’Alberto Giacometti, vase noir incisé de motifs du sculpteur, vase peint par Christian Bérard). © D.R.
Aux antipodes de la vulgate moderniste
En 1998, Bruno Foucart et Jean-Louis Gaillemin publient chez Norma Les Décorateurs des années 40, un ouvrage jalon dans l’histoire du goût français pour les arts décoratifs. Leurs travaux s’inscrivent dans un vaste mouvement de redécouverte né dans les années 1960. Dans un entretien accordé à Jean-Louis Gaillemin pour sa monographie Félix Marcilhac. Passion Art déco (Le Passage, 2014), Yvonne Brunhammer, ancienne directrice du musée des Arts décoratifs, à Paris, dit d’un ton un tantinet provocateur : « Art déco ? Ah non, ce n’est pas nous qui l’avons inventé, c’est avant tout un mot d’antiquaires. » Si les marchands de la Rive gauche ont joué un rôle majeur dans cette dynamique, le terme « Art déco » apparaît en 1966 lors de l’exposition « Les Années “25”. Art déco/ Bauhaus/Stijl/Esprit nouveau » (musée des Arts décoratifs), où sont montrés pour la première fois les objets ayant appartenu à Jacques Doucet (donation Dubrujeaud) et l’aménagement de l’appartement de Jeanne Lanvin conçu par Armand-Albert Rateau. L’Art déco désigne alors une infime part du mobilier des années 1920. Toujours en 1966, l’assistante italienne d’Yvonne Brunhammer, Giulia Veronesi, publie Stile 1925. Ascesa e caduta Triomphe et chute des «Arts déco»], englobant dans ce pluriel l’arch-tecture – un parti pris également adopté deux ans plus tard au Grolier Club, à New York, puis en 1971 au Minneapolis Institute of Art.
En cernant les enjeux mondains, sociétaux de la clientèle, Bruno Foucart et Jean-louis Gaillemin ont réussi avec brio à faire oublier la querelle entre anciens et Modernes.
Si le Bauhaus allemand ou le Mouvement moderne de Le Corbusier sont des courants qui semblaient aller de soi, cela n’a jamais été le cas de l’Art déco, et rien n’est plus troublant que de poser des mots sur un mouvement artistique dont il est difficile de connaître les dates précises et, surtout, les influences. Les historiens d’art jouent dès lors des coudes pour imposer des artistes méprisés par « les corbuséens ». « Jusqu’au début des années 1970 et même 1980, rappelle Jean-Louis Gaillemin, ces productions “innommables” étaient reléguées dans l’ombre par les historiens modernistes qui n’y voyaient que des objets artisanaux, “surchargés d’ornements”, réalisés dans des “matériaux luxueux” et pour une clientèle “huppée”. Aux antipodes des objets utilitaires fabriqués industriellement pour l’“Existenzminimum” du prolétaire, les créations “décoratives” de l’époque étaient l’objet d’un mépris général. »
Le « Style 1925 » est donc étudié dès la fin des années 1960 et tout au long des années 1970 – le « Cinquantenaire de l’Exposition de 1925 » est organisé en 1976-1977 au musée des Arts décoratifs –, et les nombreuses monographies publiées ensuite élargissent le sujet en dépassant ses bornes chronologiques et en posant la question de la continuité des styles après la crise de 1929. Le livre Les Décorateurs des années 40 n’arrive pas ex nihilo, mais fait suite notamment à André Arbus architecte-décorateur des années 40 d’Yvonne Brunhammer ou à Dupré-Lafon décorateur des millionnaires de Thierry Couvrat Desvergnes. Une synthèse manquait toutefois, et l’ouvrage est surtout une graine plantée à un moment où une kyrielle de chercheurs prennent à bras-le-corps des sujets auparavant jugés trop difficiles en raison de l’accès limité aux sources et aux œuvres.
Oser les années 1940
Jean-Louis Gaillemin est le premier. Soutenant sa thèse de doctorat en 2001, Architecture et surréalisme (1909-1935), il met en valeur la période « surréalisante » d’Emilio Terry, auquel il a consacré dès la fin des années 1970 plusieurs articles. L’un de ses chevaux de bataille était de faire le lien entre surréalisme et critique du modernisme à partir de 1930. En s’appuyant sur l’idée d’architecture organique prônée par Tristan Tzara, ainsi que sur un texte publié dans Minotaure par Roberto Matta, Jean-Louis Gaillemin montre comment Salvador Dalí et les surréalistes ont remis à l’honneur l’Art nouveau comme un pied de nez aux Modernes.Dans l’avant-propos, « Contre tout contre », du catalogue de l’exposition qu’il présente au Grand Palais, à Paris, en 2007, Design contre design, Jean-Louis Gaillemin écrit que « la perspective historique est devenue aujourd’hui d’une telle complexité qu’elle ne signifie plus rien ». Habile stratagème pour sortir des frontières établies et rappeler que le design qu’il enseigne à Paris 4 n’est pas coupé du passé : on y trouve, entre autres, un rocaille revival dans l’Art nouveau ou un Biedermeier revisité dans la Wiener Werkstätte.
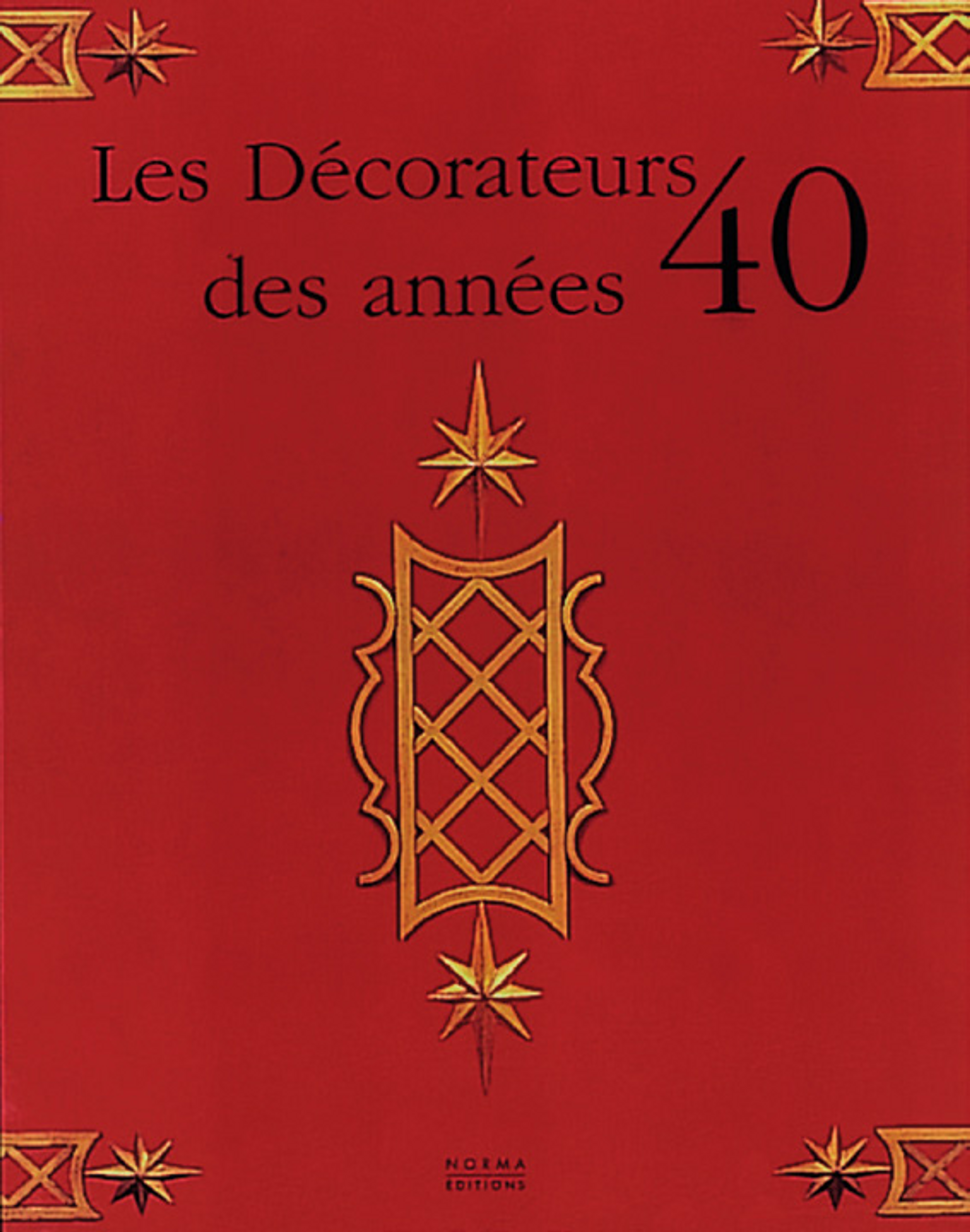
Bruno Foucart et Jean-Louis Gaillemin, Les Décorateurs des années 40, Paris, Éditions Norma, 1998. D.R.
Tandis qu’Emmanuel Bréon repense le musée des Années Trente (Boulogne-Billancourt) en faisant la part belle, avec Bruno Foucart, aux années 1940, à Paris 4, les étudiants s’attèlent à des sujets qui auraient été considérés comme de l’hérésie deux décennies auparavant. L’œuvre de Jean-Michel Frank – qui s’était entouré des frères Giacometti, de Dalí, de Christian Bérard et de Terry –, était l’exemple même de l’inclassable, tant il était difficile de se faire une idée de cette figure mythique dans l’univers ouaté des grands mécènes de l’entre-deux-guerres, Marie-Laure de Noailles, Madeleine Vionnet et Elsa Schiaparelli en tête. À la suite de José Alvarez, Pierre-Emmanuel Martin-Vivier s’empare du sujet et emprunte à François Mauriac le sous-titre de sa monographie publiée chez Norma, L’étrange luxe du rien. Après sa thèse de doctorat, il s’intéresse à une personnalité tout aussi énigmatique, Jean Royère, que Jean-Louis Gaillemin présentait à ses élèves en insistant bien sur le surnom dont il était affublé : « le décorateur pour coiffeurs ». Outre Frank et Royère, nous devons aux Éditions Norma la monographie d’Yves Badetz sur Marc du Plantier, l’autre méconnu des années 1930 et 1940, dont Amélie Marcilhac (lire p. 34) avait étudié les créations dès 2005. Tout aussi surprenante et à contre-courant, l’œuvre d’André Beloborodoff, défendue par Bruno Foucart, est décortiquée par une de ses étudiantes, Eugénie von Neipperg, dans sa thèse de doctorat récemment parue également chez Norma, André Beloborodoff, architecte, peintre, scénographe.
En cernant les enjeux mondains, sociétaux de la clientèle, en plaçant les notions de plaisir et de jeux au centre de leur enseignement, Bruno Foucart et Jean-Louis Gaillemin ont réussi avec brio à faire oublier la querelle entre Anciens et Modernes, qui intéresse moins les créateurs contemporains que les critiques, mais ne permet pas de classer un style aussi polymorphe que l’Art déco – en est-il un ? C’est le propos des travaux de Cécile Tajan qui s’est attaquée, archives à l’appui, à l’épineuse question de l’Union des artistes modernes (UAM). En reprenant la chronologie point par point, elle tord le cou à l’idée très enracinée qui faisait de l’UAM – créée par René Herbst, Francis Jourdain, Robert Mallet-Stevens, Charlotte Perriand, Hélène Henry et Raymond Templier – une cellule d’un combat historique livré pour le peuple par les tenants d’un art industriel et tubulaire contre une sorte de désunion des artistes anciens, nostalgiques des errances des Années folles. Querelle ou pas, les Emilio Terry, Jean Royère, Jacques Adnet, Jean Dunand ou Charlotte Perriand sont aujourd’hui à la page… et ont même engendré des revivals chez les décorateurs contemporains.


