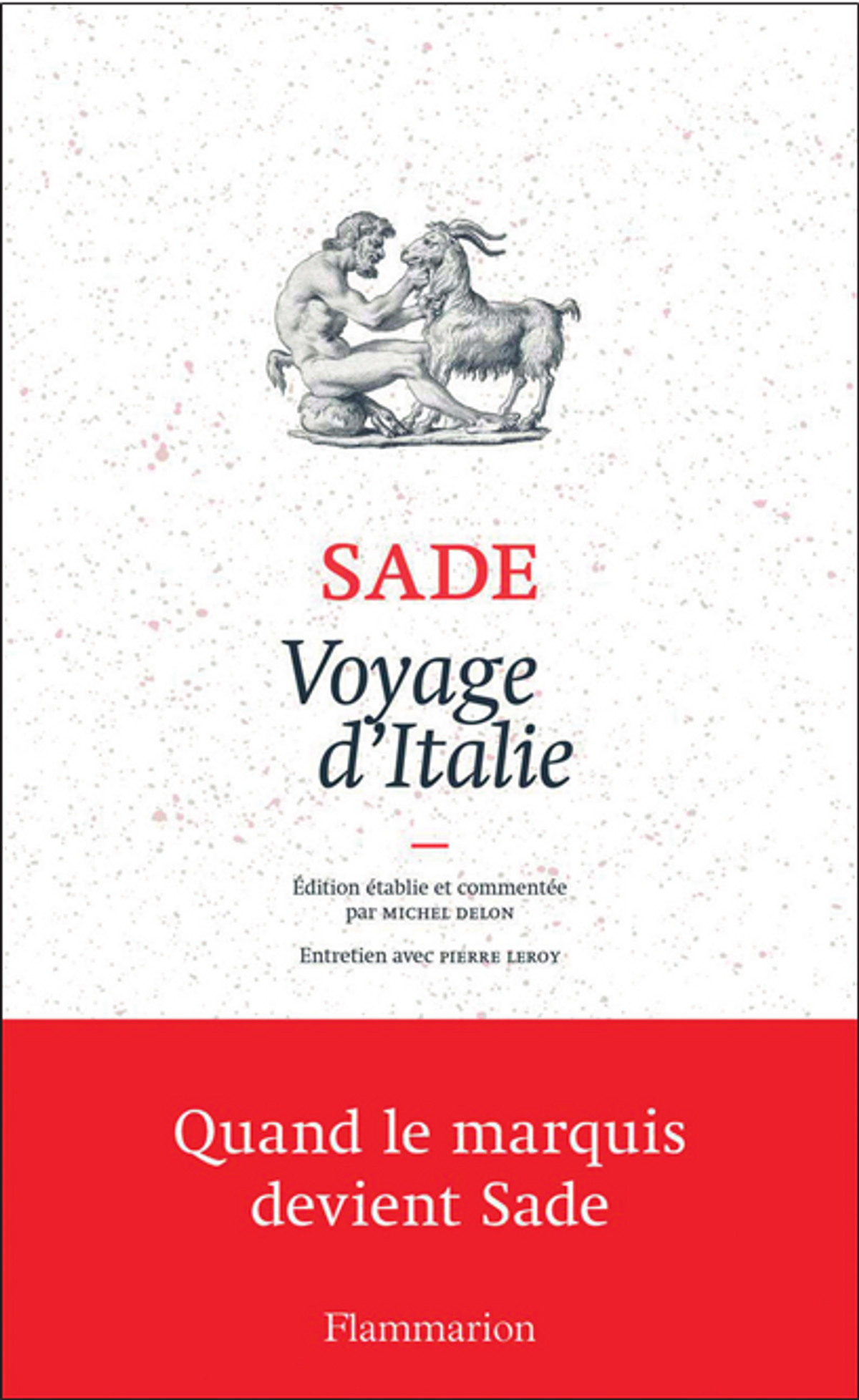Et si Sade accédait au statut d’historien ou de critique d’art ? La partie n’est pas jouée, mais les dés sont lancés. Flammarion a en effet confié à Michel Delon la publication d’un texte conservé en mains privées et peu cité par les historiens du goût. Fuyant la France où il aurait dû être arrêté, Donatien Alphonse François de Sade séjourne une année en Italie, à partir de juillet 1775, et s’attelle à un vaste chantier qu’il n’achèvera jamais, mais qui nourrira l’ensemble de ses futurs travaux, en particulier Justine ou les Malheurs de la vertu. Voyage d’Italie de Sade n’est pas un Rome, Naples et Florence sadien, nous sommes loin du propos de Stendhal. Ce n’est pas non plus une simple documentation.
Sade plonge dans le passé italien pour y dénicher quelques-uns des topoi qu’il fait mine de dénoncer, mais qu’il reprendra à son compte dans ses écrits les plus sulfureux, tel le récit des crimes commis contre sainte Agnès, violée dans un lupanar. Si le texte fourmille aussi d’anecdotes plus osées les unes que les autres – Sade reste Sade – et s’il s’y montre fasciné par l’expérience du mal, il accorde une prééminence à l’histoire de l’art. Il est indéniable qu’il s’est plongé dans l’abondante littérature artistique publiée par les Français. Les erreurs de jugement de ceux-ci le heurtent, comme dans l’église San Francesco a Ripa (Rome) où, face au Jésus mort sur les genoux de sa Mère, il affirme que « le morceau est fort, d’un ton un peu gris, mais d’une grande correction et pureté de dessin. On l’attribue à Annibal Carrache. J’ai peine à croire qu’un si grand artiste ait fait de telles bévues. » Idem à Sainte-Cécile-du- Trastevere (Rome) : « Au fond de l’église, au mur du rond-point est un tableau, dit du Guide, représentant le martyre de la sainte. Mais ce morceau m’a paru froid. On a de la peine à y reconnaître sa manière et je ne le crois pas de lui. » À propos des ruines situées à proximité de la Villa d’Este, il s’offusque ainsi : « C’est à tort que M. de Lalande assure que ces voûtes servaient d’écuries au château de Maecenas (voyez si c’est vrai) et qu’il appuie son jugement sur ce ruisseau qui y passe et qui, dit-il, servait à abreuver les chevaux. Il faudrait mettre quelque temps non à l’écurie, mais à l’étable, des gens assez ineptes pour écrire sans aucune autorité de pareilles sottises, dont le mensonge peut se vérifier avec d’autant plus de facilité qu’il n’y a personne dans le pays qui puisse attester que c’est modernement que ce canal a été conduit sous ces voûtes. »
Au-delà de ces questions de connoisseurship, le marquis de Sade livre surtout une analyse riche sur les liens entre l’antique et le moderne ou, plutôt, sur la façon dont les artistes et les habitants de Rome, Florence ou Naples intériorisent les récits artistiques du passé, jusqu’à en faire force de loi. En bon Français, il se demande si la réception de l’antique ne serait pas une source utile pour légitimer les écarts de ses contemporains italiens et, finalement, ceux de ses futurs per- sonnages. Enfin, son commentaire sur les jardins de la Villa Médicis n’est pas non plus dépourvu de sel : « [...] il sert communément de rendez-vous aux amours naissantes. On y fait des arrangements ; on en noue ; on en délie : je ne sais pas même si on ne les y conclut pas quelquefois. Ce qu’il y a de sûr, c’est qu’on le pourrait, je crois, avec sécurité. »